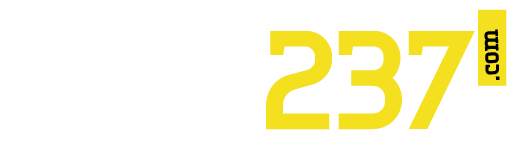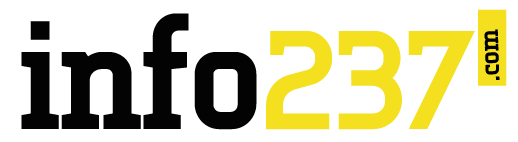Sous la médiation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Kinshasa et Kigali viennent de franchir une étape majeure. Après des années de tensions et de déplacements massifs de populations, les deux capitales ont scellé un accord de principes pour permettre le rapatriement volontaire de dizaines de milliers de réfugiés.
Les pourparlers, tenus du 22 au 24 juillet à Addis-Abeba, ont abouti à un communiqué conjoint signé par les représentants des deux pays. La République démocratique du Congo était représentée par le vice-premier ministre Jacquemain Shabani Lukoo, tandis que le Rwanda, d’abord représenté par son ministre en charge des Urgences, a finalement confié la signature à l’ambassadeur et général Karamba.
Selon le ministère congolais de l’Intérieur, l’accord repose sur le respect du caractère volontaire du rapatriement, la recherche de solutions durables et la coordination étroite avec le HCR. Les deux parties affirment vouloir s’appuyer sur les avancées diplomatiques récentes, notamment l’accord de paix signé à Washington et la déclaration de principes adoptée à Doha entre Kinshasa et le mouvement M23-AFC.
Derrière les engagements politiques se cache un défi de taille. Le HCR estime à environ 132 000 le nombre de réfugiés rwandais installés en RDC et à 135 000 celui des réfugiés congolais présents au Rwanda. Ces mouvements de population trouvent leur origine dans des décennies de crises politiques, de violences armées et d’instabilités chroniques dans la région des Grands Lacs.
Pour que ce processus porte ses fruits, il faudra garantir la sécurité des personnes rapatriées, assurer leur réinsertion économique et sociale et maintenir un dialogue permanent entre gouvernements, agences internationales et acteurs locaux. Les précédentes tentatives de retour se sont parfois heurtées à des obstacles logistiques, à l’absence de suivi ou à un contexte sécuritaire défavorable.
Si la mise en œuvre de cet accord reste un défi, il marque toutefois une avancée diplomatique importante. Dans une région souvent marquée par les tensions, chaque pas vers la coopération et la stabilité constitue un signal positif. La balle est désormais dans le camp des autorités pour transformer cet engagement en réalité concrète, au bénéfice des réfugiés et de la paix régionale.