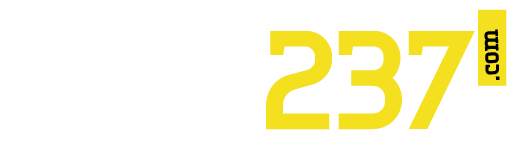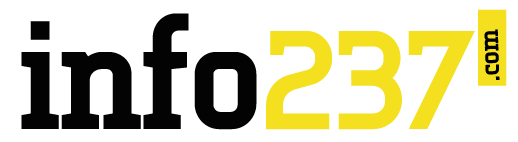Le mécanisme d’accès et d’allocation (AAM) mis en place pour lutter contre la mpox a marqué un tournant décisif dans la gestion de l’épidémie en Afrique. Face à la recrudescence actuelle de la maladie, neuf pays africains particulièrement touchés ont reçu une allocation de 899 000 doses de vaccin. Cette mesure a été décidée en concertation avec les autorités locales, les donateurs et les partenaires internationaux, dans le but de garantir une répartition équitable et efficace des doses disponibles pour maîtriser les flambées épidémiques.
La coordination des actions a impliqué plusieurs institutions majeures : les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique), la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du vaccin, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces organisations ont validé l’allocation après examen des recommandations d’un comité technique indépendant, qui a évalué l’état de préparation des pays ainsi que les données épidémiologiques. Les décisions prises ont donc été guidées par des critères scientifiques et une approche axée sur l’urgence sanitaire.
Les pays bénéficiaires de cette première phase de vaccination sont l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Libéria, le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Parmi ces nations, la RDC se distingue comme le pays le plus touché, concentrant 80 % des cas confirmés en laboratoire en Afrique cette année. En conséquence, la majorité des doses, soit 85 %, seront allouées à ce pays, dans un effort de soutien ciblé.
Les vaccins distribués proviennent de plusieurs sources internationales : le Canada, l’Alliance du vaccin Gavi, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. L’UE, à travers les contributions de pays comme l’Allemagne, la France, l’Espagne et bien d’autres, a joué un rôle clé dans le financement de cette opération. Cette solidarité internationale est un facteur déterminant dans la lutte contre cette épidémie qui continue de faire des ravages sur le continent.
La situation en Afrique est d’autant plus préoccupante que la mpox, précédemment connue sous le nom de variole du singe, connaît une recrudescence marquée en 2024. Depuis le début de l’année, plus de 38 000 cas suspects ont été signalés, accompagnés de plus de 1 000 décès. La RDC, en particulier, reste l’épicentre de l’épidémie, avec une majorité des cas recensés dans le pays. À la mi-août, l’OMS a qualifié cette flambée de mpox d’urgence de santé publique de portée internationale. En parallèle, les CDC-Afrique ont émis une déclaration similaire, soulignant l’urgence sanitaire à l’échelle du continent.
La vaccination, bien que cruciale, n’est qu’un volet de la stratégie globale de riposte à la mpox. Cette dernière inclut également le dépistage et le diagnostic rapides, une prise en charge clinique efficace des malades, des mesures de prévention des infections et une mobilisation des communautés touchées. Les vaccins sont spécifiquement recommandés pour limiter la transmission du virus et pour freiner la propagation des flambées épidémiques.
Ces dernières semaines, des campagnes de vaccination limitées ont été entamées en République démocratique du Congo et au Rwanda, marquant les premières étapes concrètes d’un déploiement progressif des doses. L’allocation de vaccins à neuf pays constitue un jalon important, offrant un espoir tangible de pouvoir endiguer plus efficacement les épidémies actuelles.
La lutte contre la mpox en Afrique est loin d’être terminée, mais grâce à cette approche coordonnée et à la solidarité internationale, les perspectives de contrôle de l’épidémie se renforcent. L’allocation de ces vaccins constitue un geste fort dans la réponse africaine à cette menace sanitaire, mais il est clair que la collaboration entre gouvernements, agences internationales et acteurs du secteur privé sera essentielle pour éradiquer cette épidémie et prévenir de futures crises sanitaires.