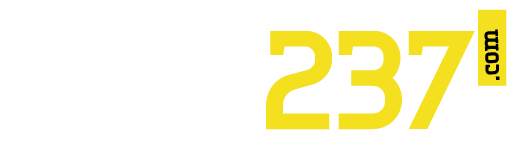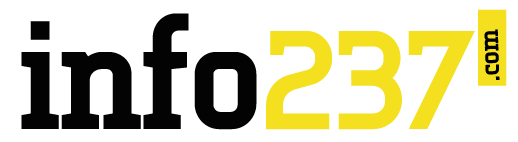Depuis le 7 août 2025, les délégué·es de plus de 170 pays se retrouvent à Genève pour ce qui s’annonce comme une négociation cruciale : parvenir à un accord international juridiquement contraignant pour enrayer la pollution plastique. L’urgence est réelle. Selon les projections, la production mondiale de plastique pourrait tripler d’ici 2060 si rien n’est fait. Lancé en 2022 sous l’égide des Nations unies, ce cycle de discussions vise à agir sur l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production à sa gestion en fin de vie.
La précédente session de négociations, qui s’est tenue fin 2024 à Busan, en Corée du Sud, s’est soldée par un échec, aucun consensus n’ayant pu être trouvé. Genève est donc considérée comme le rendez-vous de la dernière chance. Pourtant, comme lors des précédentes discussions, les représentants de l’industrie plastique et fossile sont nombreux à s’être invités à la table des pourparlers. Mediapart a pu consulter la liste des accrédités à la session genevoise, qui compte au moins 114 lobbyistes issus des grandes multinationales du plastique, du pétrole ou de la chimie.
Parmi eux figurent six représentant·es de Coca-Cola, le plus grand pollueur plastique mondial selon plusieurs ONG, ainsi que des délégués de Nestlé, Lego ou encore de l’alliance Toy Industries of Europe. Le marché de l’eau en bouteille, secteur clé pour Nestlé, a augmenté de 73 % entre 2010 et 2020. L’enjeu est donc considérable pour ces groupes, qui freinent toute volonté de réduction de la production. Leur stratégie repose sur la promotion du recyclage comme solution miracle, malgré des données scientifiques claires montrant ses limites : le taux de recyclage mondial stagne autour de 9 %.
Les groupes pétroliers et chimiques sont eux aussi bien représentés. ExxonMobil a envoyé sept lobbyistes, tandis que BASF, Dow ou Sabic défendent activement leurs intérêts. Le plastique, issu à 99 % de ressources fossiles, constitue un débouché majeur pour l’industrie pétrolière en quête de diversification. D’après l’Agence internationale de l’énergie, la pétrochimie représente déjà 15 % de la consommation mondiale de pétrole. À travers des ONG écrans comme l’Alliance to End Plastic Waste, fondée entre autres par Shell et Chevron, ces intérêts économiques influencent activement le contenu du traité.

La présence de lobbyistes ne se limite pas aux secteurs privés. Certaines délégations officielles comptent également en leur sein des membres d’associations professionnelles de l’industrie. Le Chili, par exemple, a accrédité une représentante de l’Asipla, l’association chilienne des industriels du plastique. La Chine a intégré un membre de sa fédération pétrochimique, et l’Iran est venu avec deux ambassadeurs de son industrie.
Selon plusieurs ONG présentes à Genève, les articles les plus sensibles du futur traité sont ceux portant sur la définition des produits plastiques et la régulation de leur production. L’article 6, en particulier, est l’objet d’intenses manœuvres. Les industriels tentent de réduire sa portée afin d’éviter toute obligation de réduction de la production. Lisa Pastor, chargée de plaidoyer pour Surfrider Foundation Europe, explique que ces représentants mènent une campagne de désinformation, affirmant qu’il manque des données sur les effets du plastique sur la santé. Pourtant, les études scientifiques abondent sur les impacts des microplastiques et des additifs chimiques contenus dans de nombreux objets du quotidien.
Autre sujet de discorde : les bioplastiques. L’article 5 du traité pourrait encourager leur développement, ce qui attire particulièrement les entreprises ayant investi dans ce secteur, comme TotalEnergies. Le groupe français a accrédité deux représentants de sa branche bioplastique. La France, en général, est fortement présente à travers ses groupes industriels : Danone, Veolia, Arkema, L’Oréal ou encore l’association Entreprises pour l’environnement, présidée par la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff.
Mais derrière les promesses, la réalité est moins prometteuse. Les bioplastiques ne représentent que 1 % de la production mondiale. Selon la chercheuse Marie-France Dignac, remplacer l’ensemble du plastique actuel par des matériaux issus du végétal nécessiterait l’usage de presque toutes les terres agricoles disponibles sur la planète. De plus, ces matériaux ne sont pas tous biodégradables, ni exempts d’additifs problématiques.
En marge des négociations, la société civile tente de faire entendre une voix différente. Des activistes, scientifiques et artistes se sont rassemblés autour du centre de conférence à Genève pour dénoncer l’influence excessive des lobbys. L’artiste canadien Benjamin Von Wong a notamment installé une œuvre percutante pour sensibiliser les participants à l’urgence d’agir. Lors des pourparlers précédents à Busan, plus de 220 lobbyistes avaient été recensés, soit davantage que les représentants de l’Union européenne et de ses États membres réunis. La tendance semble se confirmer, voire s’amplifier.
À l’heure où les effets du plastique sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine sont de plus en plus visibles, l’inaction serait lourde de conséquences. Si aucun accord ambitieux ne voit le jour à Genève, la planète pourrait continuer à suffoquer sous une marée de plastique incontrôlée. Le monde ne peut plus se contenter de demi-mesures. Il est temps d’adopter un traité réellement contraignant, qui s’attaque non seulement aux déchets, mais à la source même du problème : la surproduction plastique.