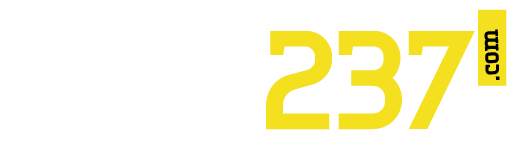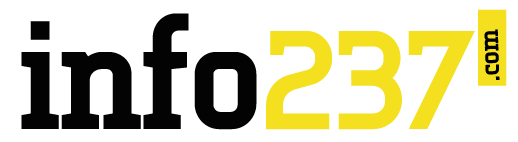L’effondrement meurtrier survenu à la falaise de Dschang, dans la région de l’Ouest du Cameroun, a plongé le département de la Menoua dans le deuil. Quatre jours après le drame, qui s’est produit le 9 novembre, le bilan humain s’alourdit, avec sept corps retrouvés sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent grâce à l’appui de pelles mécaniques, bien que l’étendue des pertes reste difficile à établir. Cet incident dramatique met en lumière les dangers qui pèsent sur cette route stratégique et appelle à des solutions urgentes pour prévenir de telles catastrophes à l’avenir.
Les origines du drame
L’effondrement de la falaise de Dschang a été principalement causé par des glissements de terrain, aggravés par des facteurs climatiques et géologiques. Le bulletin météorologique de novembre avait pourtant alerté sur des risques de glissements dans plusieurs départements, dont celui de la Menoua. Les fortes pluies ont fragilisé la falaise, déjà instable en raison de l’érosion naturelle et de la composition friable du sol.
L’activité humaine autour de cet axe a également accentué la pression sur les terres. L’urbanisation incontrôlée, combinée à la fréquentation intensive de la route par des motocyclistes et véhicules de transport, a joué un rôle dans la dégradation progressive de la falaise.

Des pertes humaines et matérielles importantes
Le double éboulement du 9 novembre a eu des conséquences dramatiques. Des passagers, des conducteurs de motos et des véhicules entiers ont été ensevelis sous des tonnes de terre. À ce jour, sept corps ont été extraits des décombres, et des recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants.
Sur le plan matériel, plusieurs véhicules de transport et infrastructures routières ont été gravement endommagés. Cette situation met en péril la mobilité sur cet axe crucial pour les échanges économiques et sociaux de la région.
Les leçons à tirer
Ce drame met en évidence la nécessité d’une meilleure gestion des risques naturels au Cameroun. Les alertes météorologiques avaient bien signalé le danger, mais elles n’ont pas été suffisamment suivies d’actions concrètes pour prévenir le pire. L’absence d’un dispositif de surveillance continue des zones à risque a laissé les populations vulnérables face à cette catastrophe.
Le rôle des autorités locales et nationales est essentiel pour anticiper de tels événements et protéger les usagers. Une vigilance accrue, accompagnée d’une communication efficace auprès des populations, doit devenir une priorité.
Quelles solutions pour sécuriser cet axe ?
Pour éviter de nouvelles tragédies, plusieurs mesures peuvent être envisagées. La stabilisation des sols est une solution primordiale. Des travaux d’ingénierie, comme la construction de murs de soutènement ou l’installation de systèmes de drainage, permettraient de renforcer la falaise et d’éviter de futurs glissements.
Une route alternative pourrait également être construite pour réduire la pression exercée sur cet axe. Cette déviation offrirait une solution temporaire en cas de fermeture de la voie principale, tout en améliorant la sécurité des usagers.
Par ailleurs, la mise en place d’un système de surveillance en temps réel permettrait d’alerter les populations et les autorités locales dès les premiers signes d’instabilité. Cette mesure, associée à une interdiction stricte des constructions anarchiques autour des zones fragilisées, réduirait considérablement les risques.
Un appel à l’action
L’effondrement de la falaise de Dschang doit servir d’avertissement pour les autres régions à risque du Cameroun. La sécurisation des axes routiers nécessite des investissements urgents et soutenus pour protéger les populations et préserver les infrastructures vitales.
Les autorités, les experts et les populations doivent collaborer pour identifier les zones vulnérables, mettre en place des dispositifs d’alerte précoce et renforcer la résilience des infrastructures. Ce drame ne doit pas être oublié. Il est impératif d’agir pour que la falaise de Dschang ne soit plus jamais le théâtre d’une telle tragédie.