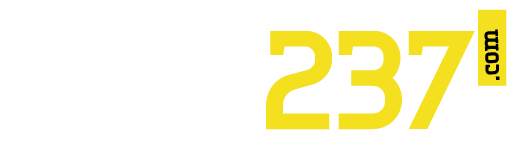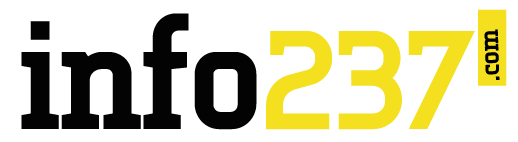Né des traditions des peuples béti du Cameroun, le bikutsi est bien plus qu’une simple danse : c’est une mémoire vivante, une forme d’expression collective et un lien avec les racines. Le chanteur Blick Bassy l’a récemment remis à l’honneur dans son conte musical afro-futuriste Bikutsi 3000, imaginant une armée de femmes dansant pour libérer l’Afrique d’ici 2050. Cette vision s’inscrit dans une longue histoire où le rythme frappe-sol a toujours été synonyme de résistance et de fierté culturelle.
Des racines traditionnelles à la modernité
Le mot « bikutsi » signifie littéralement « danser en frappant le sol ». Historiquement, ces soirées dansées étaient des moments privilégiés où les femmes transmettaient des messages codés, mêlant chants, percussions et mouvements frénétiques.
À partir des années 1960, le bikutsi connaît sa première transformation majeure avec l’influence de la rumba congolaise et l’invention de la « guitare-balafon » par Messi Martin, membre du groupe Los Camaroes. Cette innovation donne un son électrique unique, qui marque la naissance du bikutsi moderne.
Les années 1980 : explosion créative et reconnaissance
Dans les années 80, le genre connaît un véritable âge d’or. Des groupes comme Mekongo Président, Les Super Volcans ou Les Vétérans définissent de nouveaux codes, tandis qu’Anne-Marie Nzié s’impose comme la « reine du bikutsi ».
Cette période voit également naître une scène professionnelle avec des studios, des labels et des lieux emblématiques à Yaoundé où se produit la crème des artistes. L’internationalisation commence avec des collaborations marquantes, mêlant musiciens camerounais et artistes venus d’Afrique et des Caraïbes.
Les Têtes Brûlées : l’icône punk du Cameroun
Au milieu des années 80, le guitariste Zanzibar et le chanteur Jean-Marie Ahanda révolutionnent l’image du bikutsi avec le groupe Les Têtes Brûlées . Peints, audacieux et énergiques, ils sont présentés comme « les punks africains » sur les scènes européennes. Leur succès ouvre la voie à une reconnaissance mondiale, malgré la disparition prématurée de Zanzibar, véritable légende du genre.

L’ouverture à l’international
De Paul Simon à Shakira, plusieurs artistes étrangers se sont inspirés du bikutsi, séduits par sa complexité rythmique et sa puissance scénique. Cette influence internationale a contribué à inscrire ce rythme dans le patrimoine musical mondial, tout en offrant aux musiciens camerounais de nouvelles opportunités.
Les femmes reprennent la scène
Si le bikutsi a longtemps été dominé par les hommes après sa modernisation, la fin du XXᵉ siècle marque un retour en force des femmes. Sally Nyolo, Lady Ponce ou encore K-Tino apportent chacune leur style, de l’authenticité acoustique à la provocation assumée.
Toutefois, l’émergence d’un « bikutsi porno » a suscité débats et controverses, poussant la Société nationale camerounaise des droits d’auteur à envisager des sanctions contre les œuvres jugées trop explicites.
Un patrimoine à préserver
Aujourd’hui, le bikutsi continue d’évoluer, porté par de nouvelles générations d’artistes qui mêlent tradition et innovations sonores. Il reste un symbole identitaire fort pour le Cameroun, un rythme capable de raconter l’histoire d’un peuple tout en séduisant les scènes internationales.
Préserver le bikutsi, c’est préserver une partie de l’âme culturelle camerounaise, un héritage vivant qui, comme le battement d’un tambour, résonne à travers le temps.