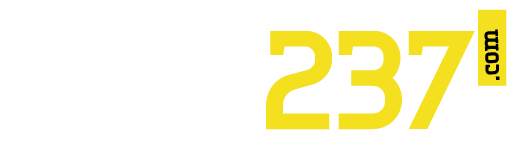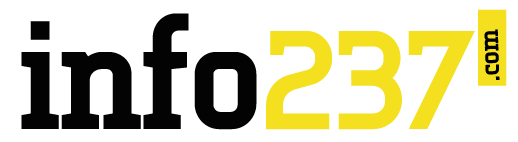À la veille de la rentrée scolaire au Cameroun, les écoles clandestines, malgré leur interdiction officielle, continuent de fleurir. Poussées par l’inefficacité du système éducatif public et la précarité des populations, elles s’imposent comme une solution par défaut pour des milliers de familles.
À Douala, dans le quartier populaire du Bois des singes, le directeur de l’école primaire privée Michel Ismaël reçoit parents et élèves avec un sourire confiant. La rentrée approche et l’établissement affiche complet. Pourtant, cette école figure sur la liste des 494 établissements privés déclarés illégaux par le ministère de l’Éducation de base, en août 2023. Officiellement interdite d’ouverture pour l’année scolaire 2023-2024, elle continue de fonctionner comme si de rien n’était. Le directeur affirme détenir un agrément, mais aucun document ne le prouve. Ce flou administratif n’empêche pas les parents d’élèves, comme Céline, mère de cinq enfants, de continuer à inscrire leurs jeunes, certains ayant déjà réussi leur certificat d’études primaires dans cette même structure.
La situation n’est pas isolée. Dans plusieurs régions du pays, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées comme Douala, les établissements scolaires privés non agréés se multiplient. Le chiffre a bondi de 326 à 494 en une seule année. Cette croissance s’explique par une demande croissante, couplée à l’incapacité de l’État à garantir un accès équitable et de qualité à l’éducation publique. L’argument est simple : là où il n’y a pas d’école publique, ou lorsqu’elle est surchargée, les écoles privées, même illégales, deviennent une alternative.

Les conditions de création d’un établissement scolaire privé sont strictes au Cameroun. Il faut, entre autres, être titulaire d’un diplôme adéquat, posséder un terrain en propre, disposer d’un permis de construire et de fonds suffisants pour garantir le fonctionnement de l’établissement pendant au moins trois mois. Or, dans les faits, de nombreux promoteurs d’écoles s’installent sur des terrains non constructibles, comme au Bois des singes, qui est un domaine privé de l’État. L’État interdit toute construction sur ces terrains, mais la réalité sociale l’emporte : plus de 50 000 personnes y vivent sans service éducatif public. Les écoles clandestines remplissent donc un vide.
Cette informalité s’étend aussi à l’enseignement secondaire. Sur les 59 établissements secondaires privés non autorisés recensés à Douala, dix sont implantés dans ce même quartier. Selon les syndicats d’enseignants, la prolifération de ces écoles clandestines illustre une tendance lourde : la privatisation croissante du secteur éducatif dans un contexte de désengagement de l’État. Pour beaucoup, l’éducation est devenue un marché lucratif, malgré les risques pour les élèves en termes de qualité de formation, de sécurité et de suivi pédagogique.
Les familles, elles, y voient un moindre mal. Le coût d’inscription y est souvent plus accessible que dans les écoles privées agréées, et les classes sont moins surchargées que dans le public, où plus de cent élèves peuvent s’entasser dans une seule salle. À défaut d’avoir les moyens d’inscrire leurs enfants dans des établissements prestigieux, les parents préfèrent miser sur des structures clandestines proches de leur domicile, convaincus qu’elles offrent tout de même de meilleures conditions que l’école publique, souvent en ruine.
Cette situation est aussi alimentée par le malaise croissant du corps enseignant. Nombre d’instituteurs et de professeurs du public, mal rémunérés et souvent en attente de leurs primes ou arriérés de salaire, enseignent à titre privé dans ces écoles illégales. Ces cours en marge de leurs heures officielles leur permettent de compléter leurs revenus. Les autorités ferment souvent les yeux sur ces pratiques tant elles sont devenues courantes, et les tentatives de sanction peinent à s’appliquer dans un système gangrené par le sous-financement et les lourdeurs administratives.
La menace d’un mouvement de grève à la rentrée de septembre 2023 a été évitée de justesse, mais les tensions restent vives. Pour les syndicats d’enseignants, tant que les revendications légitimes du personnel éducatif ne seront pas prises en compte, les écoles clandestines continueront de prospérer. Car elles offrent non seulement une solution aux familles mais aussi une échappatoire économique à des enseignants en difficulté.

Le ministère de l’Éducation de base a pourtant promis un durcissement des contrôles et des sanctions. Mais sur le terrain, la régularisation administrative reste lente, et l’application des fermetures annoncées reste théorique. Dans certains cas, les écoles ferment un jour pour rouvrir le lendemain sous un autre nom ou avec un simple déplacement de quelques rues. Un jeu de cache-cache facilité par le manque de moyens des services de contrôle et une corruption endémique qui fragilise les décisions gouvernementales.
Alors que l’éducation est censée être un pilier fondamental du développement, la situation au Cameroun met en lumière une réalité inquiétante : sans une politique publique forte, inclusive et rigoureusement appliquée, l’avenir scolaire de milliers d’enfants reste entre les mains d’opérateurs privés plus ou moins compétents. Les écoles clandestines, loin d’être un phénomène marginal, sont devenues un symptôme d’un système éducatif en crise profonde. Et pour beaucoup de familles, elles resteront, malgré tout, la seule issue pour espérer offrir un avenir meilleur à leurs enfants.