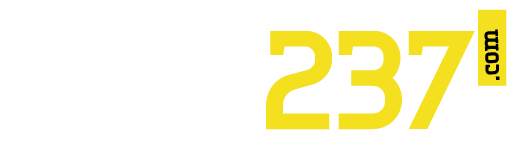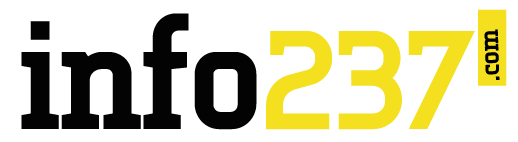Le bikutsi, une musique profondément enracinée dans les traditions camerounaises, est un genre musical qui incarne l’âme du pays. Né au cœur des forêts d’Afrique centrale, ce style musical trouve ses origines dans les danses rituelles des peuples Béti et Beti-Pahuin, où les femmes se rassemblaient au clair de lune pour frapper le sol en rythme avec des percussions. Le mot "bikutsi" signifie d’ailleurs "danse-frappe-sol", une référence directe à ces mouvements frénétiques et à l’énergie brute qui caractérisent encore ce genre musical aujourd’hui.
Au fil du temps, le bikutsi s’est adapté aux évolutions sociales et technologiques, intégrant des instruments modernes et des influences extérieures, tout en restant fidèle à ses racines. La première grande transformation survient dans les années 60, après l’indépendance du Cameroun. L’influence de la rumba congolaise et de la musique des grandes figures africaines comme Franco et Tabu Ley se fait sentir. Mais c’est dans les années 70, avec l’orchestre Los Camaroes et des musiciens comme Messi Martin, que le bikutsi commence à prendre une nouvelle forme. Ce dernier introduit la fameuse "guitare-balafon", un mariage ingénieux entre la guitare électrique et le son traditionnel du balafon, créant ainsi une texture sonore unique qui va propulser le genre dans une ère moderne.
Dans les années 80, le bikutsi s’affirme comme une alternative à d’autres genres populaires comme le makossa, avec des groupes emblématiques comme Les Grands Esprits, Mekongo Président, et surtout Les Vétérans. C’est à cette époque que des artistes comme Anne-Marie Nzié et Mama Ohandja participent activement à la structuration de la scène bikutsi. Anne-Marie Nzié, surnommée la "reine du bikutsi", se distingue en apportant une dimension plus féminine au genre, tout en contribuant à son essor avec des titres populaires comme Liberté (Dieu Merci).
Dans les années 80, le bikutsi atteint une dimension internationale grâce à l’album Bikutsi 80 et aux Têtes Brûlées. Ce groupe emblématique, avec le guitariste légendaire Zanzibar, va révolutionner le genre en le propulsant sur la scène internationale. Le groupe est repéré par Jean-Marie Ahanda et soutenu par le concours Découvertes RFI en 1987, ce qui leur permet de se produire en Europe et de faire connaître le bikutsi au-delà des frontières camerounaises. L’album Man No Run, un documentaire réalisé par la cinéaste Claire Denis, témoigne de l’impact de ce groupe, qui s’impose comme l’ambassadeur du bikutsi à travers le monde.
L’influence de ces pionniers ne s’arrête pas aux frontières du Cameroun. Le bikutsi a su séduire des artistes internationaux comme Paul Simon, qui s’est inspiré de ses rythmes pour son album The Rhythm of The Saints en 1990, ou encore le violoncelliste Vincent Ségal, qui a été marqué par sa rencontre avec les musiciens camerounais. De cette collaboration est née une admiration mutuelle, prouvant que le bikutsi, bien que profondément camerounais, est un genre aux échos universels.
Aujourd’hui, même si le bikutsi reste très populaire au Cameroun, il peine à se faire une place de choix sur la scène musicale internationale. Toutefois, grâce à des artistes comme Blick Bassy, qui revisite le genre dans un spectacle futuriste intitulé Bikutsi 3000, et à l’évolution de ses rythmes et instruments, le bikutsi continue de séduire les générations modernes tout en restant fidèle à ses racines ancestrales.
Du bikutsi traditionnel des forêts camerounaises à sa version moderne, enrichie de sonorités électriques et influencée par la scène internationale, ce genre musical témoigne de la richesse culturelle du Cameroun et de l’ingéniosité de ses artistes, qui ont su faire évoluer un patrimoine sans en altérer l’essence.